Publier Le 10/06/2009
Les hommes de ma génération savent encore le nom, un instant sur toutes les bouches pendant leur enfance, de Jacques Lebaudy, un homme d’affaires français qui, embarrassé par sa fortune et emporté par l’esprit d’aventure, avait conçu le projet romanesque, dont les journaux s’amusèrent alors, de fonder pour son propre compte un empire au Sahara.
Quinze ans plus tard Pierre Benoit, tirant parti de légendes du Hoggar et de la découverte archéologique du tombeau de la reine touarégue Tin Hinane, imaginait son roman de l’Atlantide. De l’histoire à demi vécue de deux officiers sahariens, il faisait sortir des solitudes du Hoggar le mirage d’une mystérieuse principauté berbère défendue par la solitude contre les curiosités de l’Occident.
En 1952 les choses ont bien changé. Un projet de loi vient d’être déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale pour proclamer l’intégration du Sahara au territoire national et décider de la création de « départements français » au cœur du grand désert. En effet, depuis quelques mois, des publicistes, des économistes et des financiers ont lancé l’idée, à la suite d’entretiens, de discussions et de publications dont la presse a fait connaître la teneur1, de favoriser par une telle décision gouvernementale l’exploitation industrielle du Sahara. Il s’agirait essentiellement de placer une partie au moins de ses territoires sous l’autorité unique et directe de la métropole, de manière à pouvoir donner une vive impulsion aux entreprises minières, dans des conditions qui réserveraient à la France l’initiative qui lui revient, puisque c’est elle-même qui a contribué, au prix d’un demi-siècle d’efforts, à ouvrir l’accès de ces régions impénétrables. Les initiateurs de ce projet avancent, avec quelque pertinence, que, si notre pays se désintéressait de cet avenir, d’autres Puissances ne tarderaient pas à prendre
____________________________________________
1. Hommes et Mondes, mai 1951 et suivants ; Figaro, 5 et 6 octobre ; le Monde, 30 mai et 26 octobre.
Cette ouvre à leur compte. Le désert a, on le voit, cessé d’être la terre du rêve pour devenir un des espaces du ,onde où peuvent se heurter les convoitises des grands Etats en même temps que l’ambition des stratèges et l’imagination des créateurs de Puissances industrielles.
Ce changement d’attitude n’a pas été cependant aussi brusque qu’il peut paraître. Depuis qu’a été achevée, en 1934,la pacification du grand désert d’Afrique, deux grands projets, partiellement réalisés d’ailleurs, ont attiré l’attention des économistes sur cette partie déshéritée du continent. Dans la boucle du Niger, à la limite sud du désert, dans ce delta intérieur où se perdaient inutilement les eaux du fleuve, la construction de grands barrages a permis avant la guerre d’entreprendre de vastes travaux d’irrigation. Les initiateurs de cette œuvre espéraient réussir ainsi à transformer le delta intérieur du Niger en une zone aussi riche, par ses plantations de coton, que la Djezireh du Haut Nil dans le Soudan anglo-égyptien. D’autre part, depuis 1932, le projet d’un chemin de fer transsaharien _ de Gao à Nemours _ était étudié pour relier cette nouvelle zone de peuplement de la boucle du Niger à la Méditerranée, en suivant la vieille voie historique d’un itinéraire transdésertique de caravane. Certains pensaient ainsi intéresser l’Algérie à la mise en valeur des richesses du Soudan et du Tchad.
Ces vestes desseins, il est vrai, n’ont jamais séduit en France et en Afrique qu’une partie de l’opinion. Certes, des événements internationaux sont intervenus pour limiter considérablement la réalisation des plans primitifs. Mais en même temps l’Office du Niger et la Transsaharien ont suscité l’un et l’autre de furieuses contre-attaques. Certains redoutaient que les irrigations du Niger ne consacrassent la mise en esclavage économique des populations noires transplantées, alors que l’Office du Niger se proposait au contraire de les libérer définitivement de la misère en les rattachant à l’économie moderne. D’autres dénonçaient le gaspillage d’argent que serait l’établissement d’une voie ferrée à travers le désert et qui resterait, disaient-ils, sans trafic et sans utilité réelle. Les promoteurs du Transsaharien répondaient, chiffres en mains, que les dépenses seraient réduites et donnaient l’exemple des nombreux chemins de fer transdésertiques du monde. Malgré les controverses, cependant, l’élan était donné. Le barrage de Sansanding construit, les irrigations se développèrent sur un plan plus modeste qu’on ne l’avait imaginé, mais dans des conditions qui, à tout prendre, se trouvèrent heureuses. D’autre part, le chemin de fer Méditerranée-Niger partant de Nemours poussant son avance au-delà de Colomb-Béchar se révélait, avant même d’avoir atteint le cœur du désert, un moyen incomparable de pénétration dans une vaste zone minière dont l’intérêt ne cosse depuis plusieurs années de s’accroître. Sur son axe et dans son prolongement, se poursuivent en effet de nos jours d’une manière continue des prospections, et des découvertes les plus engageantes se succèdent qui retiennent aujourd’hui l’attention des économistes.
Malheureusement ces deux projets avaient un instant intéressé le gouvernement de Vichy. Ils se trouvèrent par là même, aux yeux d’une opinion simpliste, entachés de cette réprobation qui, au lendemain de la Libération, frappa indistinctement toutes les entreprises sur lesquelles s’étaient reportés quelques espoirs pendant la difficile période de notre détresse nationale. Mais il s’agissait sur ce point d’un discrédit trop sentimental pour que la paralysie fût complète. Depuis trois ans, les recherches géologiques amènent à considérer avec attention la vaste zone qui s’étend depuis Fort-Gouraud en Mauritanie à 600 kilomètres à l’ouest de Villa Cisneros, en passant par les confins du Dra, Beni Abbès, jusqu’au Hoggar et à l’Aïr ; entre le Rio De Oro et la Libye. L’idée d’une « mise en valeur » du Sahara a ainsi repris corps, débarrassée de la plupart des préjugés qui en avaient précédemment limité la portée.
Nous trouvons intact en effet sur ces immenses territoires le vieux socle primaire africain dont les grands plissements tertiaires de l’Atlas maghrébin n’ont pas altéré la disposition. Les minces apports de sable ou sable ou les maigres fossiles des rivières intérieures du Sahara laissent presque partout à nu dans les régions centrales le squelette géologique du continent et les prospecteurs découvrent chaque jour dans ses fissures des indices de charbon, de cobalt de manganèse, de cuivre et d’étain.
Le France a ; depuis un siècle, assumé le rude tâche de pacifier ce continent désolé, et a fait l’effort d’y ouvrir des routes, d’y aménager des points d’eau. Est-ce elle qui prendra l’initiative d’une exploitation moderne ? Donnera-t-elle l’exemple des grandes entreprises conduites dans l’ordre et selon une sûre méthode ? Ou bien verrons-nous au contraire s’abattre sur ce pays, au hasard des circonstances, des sociétés puissantes de nationalités et d’attaches diverses, aux vues limitées, aux calculs égoïstes ? Déjà des demandes de recherches pétrolières, qui se paralyseront d’ailleurs les unes les autres, sont adressées à la France par des compagnies étrangères. La presse britannique elle-même, au lendemain de la découverte du riche gisement de fer de Fort-Gouraud, n’a-t-elle pas lancé, comme un ballon d’essai, l’idée d’une internationalisation du Sahara ? Il était naturel qu’en France l’opinion éclairée s’inquiétât de l’avenir du Sahara français et qu’une discussion fût instituée entre tous ceux que préoccupe l’intérêt national pour tenter d’intéresser le gouvernement et l’opinion de notre pays à des problèmes qui ne sont plus aujourd’hui colorés d’aucun romantisme. L’heure est venue, pour notre pays, de prendre position.
***
Le Sahara africain n’est que le dernier maillon de cette chaîne de déserts et de steppes de la zone subtropicale qui, depuis la Chine, l’Inde et l’Iran, se prolonge par la péninsule Arabique, les déserts d’Egypte et de Libye. A la vérité, la géographie comme l’histoire unissent pratiquement, malgré les deux coupures de la mer Rouge et du golfe Persique, en un seul bloc géographique tous les espaces vides qui s’étendent entre le golfe Persique et l’Atlantique, entre les parallèles 16° et 32° Nord.
La similitude du climat dans une région où les chutes de pluies sont inférieures à 100 millimètres par an, la prépondérance de la vie pastorale, la succession régulière des invasions de nomades berbères et arabes font de ces régions une sorte de continent à part, qui a été par excellence la zone en bordure de laquelle s’est faite_sur ses limites septentrionales et méridionales _ l’expansion de l’Islam.
Mais en même temps, dans cet immense territoire, le Sahara occidental, celui de ces déserts qui nous intéresse particulièrement et qui a pour limites mêmes celles des territoires placés sous l’autorité de la France dans le Sud algérien, l’Afrique Occidentale Française et la Tchad, a eu des destinées historiques particulières qui lui confèrent une originalité propre, sur lesquelles il nous faut réfléchir.
On sait qu’à l’aube de l’histoire cette vaste zone, aujourd’hui dépeuplée, apparaissait, par les races qui l’occupaient, comme un prolongement naturel de l’Afrique Noire. Dans les oasis du Sahara algérien et la Libye se trouvaient des populations foncées que les Grecs désignaient sous le nom de nubiens, et qui étaient peut-être de même origine que les Haoussa et Toubbous ou appartenaient aux races éthiopiennes, très différentes de celles qui occupent aujourd’hui le Soudan. Il se peut que des débris de ces populations noires, refoulées ou détruites par les invasions postérieures, aient subsisté jusqu’à nos jours dans les oasis du Touat et du Dra. Ce sont elles qui formeraient le fond primitif de ces cultivateurs noirs désignés généralement sous le nom de Haratine. Il est vrai qui la pratique de l’esclavage introduisit par la suite dans ces régions d’oasis pendant de longs siècles des éléments importés du Soudan ou même des régions bantoues, de telle sorte que nous ne sommes plus en état de retrouver avec exactitude dans les cultivateurs noirs des palmeraies sahariennes les descendants de ces habitants primitifs du Sahara.
Plus tard, les invasions de nomades berbères, dont nous ne pouvons préciser la date, mise qui sont bien antérieures aux conquêtes romaines, aboutirent à l’unification presque complète, par les premiers conquérants blancs, du désert et des zones méditerranéennes.
A partir du dixième siècle de notre ère, apparaissent à leur tour, suivant la périphérie du Sahara ; les envahisseurs arabes en Egypte, au Soudan anglo-égyptien, puis en Libye. Leurs groupes se fixent dès ce moment dans le territoire du Tchad. Puis avec les invasions puissantes des Soleim et des Beni Hilal à partir du onzième siècle, et avec celles de Maqil au treizième siècle, les vagues d’invasion déferlent sur la Tunisie, l’Algérie, le Maroc pour s’infiltrer peu à peu sur la côte atlantique en partant de l’Oued Dra vers le Sénégal. La conquête de la Mauritanie par les Arabes sur les Berbères s’achève au dix-huitième siècle. Les Berbères nomades sont confinés ou refoulés. Leurs descendants n’ occupent plus guère que le centre du désert autour de l’Aïr, du Hoggar, débordant cependant en oblique vers le nord-ouest jusqu’aux confins de l’Atlas marocain. C’est à ce moment que le peuplement ethnique du Sahara nous apparaît comme stabilisé.
Mais c’est alors que l’intervention de l’Occident va transformer les conditions de la via au désert. En dépit du caractère dévastateur et souvent violent des conquêtes berbères, le Sahara avait connu depuis le haut moyen âge une vie commerciale intense que nous n’imaginons plus aujourd’hui qu’avec peine. Il était en effet traversé du nord au sud par des grandes routes parallèles qui unissaient les royaumes noirs plus ou moins islamisés du Soudan aux rives de la Méditerranée. Parmi ces grandes routes, citons surtout celle du Tchad à Tripoli, celle du Niger à l’Oued Dra et celle du Sénégal au pays du Sous. Ces itinéraires étaient les routes des esclaves, de l’or, des cotonnades africaines ou des plumes d’autruche, parcourues du sud au nord. Au retour, elles acheminaient les objets fabriqués venus du Maghreb ou d’Europe, la poudre, les armes et la verroterie.
Dès la fin du dix-huitième siècle le développement du commerce maritime moderne sur les côtes du golfe de Guinée allait altérer le sens des échanges. Les productions de l’Occident parviennent dès lors au Soudan par le Sud et les traitants établis sur les comptoirs de l’Atlantique exportent directement par leurs navires le « bois d’ébène », la poudre d’or et l’ivoire. Les routes transsahariennes dépérissent. Bientôt les conquêtes occidentales en Afrique Noire vont achever cette décadence, cependant qu’au Maghreb même l’administration moderne des Etats rendra possibles les relations directes avec l’Europe.
Les dernières années du dix-neuvième siècle précipitent la décadence et bientôt la pacification totale des zones désertiques provoque un changement plus important encore : l’effondrement politique de la société nomade.
Si l’on veut bien comprendre les conditions dans lesquelles se pose aujourd’hui à la France et au monde entier le problème de l’exploitation moderne du Sahara, Il faut en effet tenir compte de l’immense transformation apportée à ces territoires par la pacification définitive. Et pour saisir toute l’importance de ce changement, il faut évoquer tout d’abord ce qu’était la situation politique des tribus guerrières de l’intérieur de l’Afrique Blanche au temps où celles-ci vivaient dans l’anarchie.
En Afrique, comme dans la péninsule arabique, la domination du désert appartenait naguère à quelques grandes tribus guerrières, extrêmement mobiles, utilisant pour leurs expéditions lointaines des chameaux agiles qui leur permettaient d’échapper à toutes les poursuites. Les quelques bases permanentes dont disposaient ces nomades chameliers au centre du Sahara étaient ainsi inaccessibles aux forces des gouvernements périphériques qui eussent tenté de les y atteindre. L’Empire du Maroc, l’Empire turc, les royaumes du Soudan n’osaient pas s’aventurer à les combattre dans les solitudes redoutables du grand désert. Aussi ces pasteurs guerriers capables de subsister, lorsqu’ils le voulaient, dans la partie centrale, faisaient-ils sentir le poids de leurs armes sur les tribus périphériques moins belliqueuses qui vivaient plus près des marches du désert, où l’on pratiquait plus aisément un élevage régulier. Souvent même leurs raids les menaient jusqu’aux zones sédentarisées occupées dans le Sud par les Noirs, ou dans je Nord par les tribus arabes stabilisées au pied de l’Atlas. En même temps, les maîtres du Sahara central tenaient sous leur étroite domination les habitants des oasis, ces noirs paisibles ravalés depuis des dizaines de siècles à la situation de sédentaires asservis. De temps à autre l’une ou l’autre de ces grandes tribus, lorsqu’elle était vaincue par une rivale, éclatait elle-même et se dispersait à son tour sur les rives du Sahara. On trouve encore, en étudiant l’origine ethnique des petits groupes qui sont fixée à la li,ite de la sédentarisation, des descendants de ces anciens dominateurs berbères ou arabes, dont le no, faisait, dans les siècles passés, trembler les commerçants ou les agriculteurs des confins. Ces grandes tribus, dont celle des Reguibat, célèbre par ses combats contre la France et l’Espagne il y a vingt ans, nous donne le dernier exemple, avaient cette double particularité, étrange à nos yeux, d’être à la fois militairement puissantes et matériellement très pauvres. La via au désert était pour ces guerriers une sorte d’épopée permanente, entièrement occupée par des raids à grande distance, remplie par l’exécution de vengeances entre clans rivaux, une sorte de misère héroïque dans laquelle le dénuement allait de pair avec la noblesse et la générosité fastueuse avec la pauvreté.
Lorsque la pacification des confins eut été rendue possible par la création de troupes méharistes bien organisées, pourvues d’armes modernes, appuyées par les liaisons automobiles et soutenues par les progrès matériels d’une action continue exercée pendant des dizaines d’années, le jour vint où cette société nomade guerrière du centre du désert fut à son tour contrainte à signer la paix. En rendant leurs armes, ces grands bédouins chameliers perdirent en quelque sorte leur raison de vivre. L’on vit alors se précipiter avec une rapidité jusqu’alors inconnue le grand mouvement historique, jadis assez lent, qui a toujours porté les populations nomades du centre vers la périphérie. C’est ainsi que _ de 1900 à 1950 _ le centre du désert s’est vidé peu à peu au détriment des rives du Sahara. Seuls subsistent aujourd’hui, de ces puissantes confédérations guerrières de l’intérieur, quelques groupes nomades évoluant autour de quelques points d’appui naturels et limitant leurs déplacements aux nécessités économiques du pâturage. Dans la région centrale, dont la superficie est huit fois et demie égale à celle de la France, entre le Rio-de-Oro et l’Aïr, entre l’Adrar des Iforas et la région de Beni-Abbès, on ne compte guère plus de 220.000 habitant1, parmi lesquels d’ailleurs une faible part de sédentaires d’osais. Nous sommes donc là devant une terre vide et les problèmes humains, si intéressants à résoudre qu’ils soient encore, n’ont plus ici aucune importance politique. Cette terre, déjà très pauvre, qu’habitaient seulement d’héroïques bandits, est aujourd’hui presque abandonnée par l’homme. Le désert ne vivait que grâce à la guerre.
La paix en a chassé la plupart de ses fils.
1 . L’ensemble du Sahara, en comptant les zones périphériques où les nomades ont des relations avec les sédentaires des pays côtiers, a onze fois et demie la surface de la France et un million neuf cent mille habitants nomades, y compris les Peuls, nomades sahéliens.
observons qu’il s’agit ici d’une évolution naturelle dans laquelle n’a joué, bien au contraire, aucun calcul d’éviction. Beaucoup d’officiers s’étaient pris d’amitié pour ces nomades belliqueux, si attachants, et ils eussent souhaité les voir, sur place, se transformer en paisibles pasteurs. Mais avec l’édifice politique de leur puissance a disparu le système social qui les faisait vivre. Par suite de l’établissement de la paix, les liens qui unissaient les protecteurs aux protégés, les grands nomades aux petits nomades et aux sédentaires, se sont trouvés brisés. L’attrait du rezzou, de l’expédition de pillage, ayant disparu, l’idéal plus matériel de la vie sédentaire s’est peu à peu imposé. Les nomades se sont rapprochés des centres permanents. Leurs troupeaux, dont les parcours se sont amenuisés, ont diminué peu à peu. Ceux qui vivaient sur les limites des pays agricoles en ont délibérément passé la frontière et se sont enfoncés progressivement vers les savanes herbeuses. Sur la rive sud du Sahara surtout on a observé une descente presque générale des tribus qui, peu à peu d’ailleurs, au contact des populations noires, se métissent et s’alourdissent.
Mais la paix avait encore d’autres conséquences désastreuses jusque dans les zones de bordure désormais surpeuplées. Sur les confins sahariens du Maroc, les grands nomades, qui ont conquis les oasis du Bani il y a cinquante ans, se trouvent aujourd’hui dépourvus d’autorité sur leurs sujets noirs ou sur les Berbères sédentaires qu’ils opprimaient jadis. Leurs anciens vassaux vont aujourd’hui travailler dans les mines et dans les ports, cependant qu’eux-mêmes, incapables de cultiver les palmiers, tombent peu à peu dans la misère. Bientôt les pasteurs abandonneront à leur tour ces marches frontières et s’en iront, en tentes isolées, se perdre parmi les sédentaires du Maroc du Nord.
***
Ce vide progressif du Sahara fait aujourd’hui du cœur du continent africain une terre presque sans hommes, dont la situation devient analogue à tant de déserts chauds ou froids qui parsèment la planète. Le Sahara central, avec ses richesses minières potentielles, ressemble ainsi plus ou moins à l’Alaska ou au Groenland. Les populations indigènes si dispersées qui y vivent encore en nomades ou en sédentaires d’oasis ne peuvent naturellement pas revendiquer la propriété éventuelle des mines ou des champs de pétrole hypothétiques, pas plus que les Esquimaux du Grand Nord ne pourraient réclamer de droits sur la mise en valeur de gisements d’uranium. Les problèmes changent de face. L’économie l’emporte sur la politique. Nous entrons ici dans le régime de la technique industrielle et dans le domaine presque sans partage de la puissante économie moderne.
Dans ces conditions, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et d’exploiter les ressources locales ne peut être invoqué puisqu’il n’existe pratiquement pas sur place de peuples qui occupent le pays. Il subsiste seulement çà et là de pauvres communautés humaines résiduelles, qui méritent d’ailleurs de bénéficier d’une assistance économique et morale. L’Occident, qui a ruiné leur puissance en leur imposant la paix, doit être aussi assez généreux pour permettre à ceux qui sont restés de survivre dans un monde nouveau qui leur est étranger.
A cet égard, la France est mieux placée qu’aucun autre pays pour aborder cette tâche humaine, qui n’est pas sans grandeur. Elle peut exciper d’une longue tradition d’humanité à l’égard des peuples de l’Afrique Blanche. Elle dispose de cadres admirables, de spécialistes des tribus. Qui donc mieux qu’elle pourrait apporter aux nomades Arabes, Berbères ou Teda, qui sont restés sur place, une aide comparable à celle que le Danemark a su donner aux habitants du Groenland et que l’Amérique du Nord accorde si généreusement aux Esquimaux du La broder ?
Une autre conséquence inattendue de la création progressive du « vide saharien » apparaît dans le domaine militaire. Il faut en effet ajouter aux considérations générales précédentes que le centre de l’Afrique prend aujourd’hui dans la stratégie mondiale un intérêt particulier. Au temps où les grandes routes stratégiques sillonnent les continents, le cœur du désert devient par lui-même d’une manière paradoxale une sorte de « plaque tournante », dont la nation qui l’occupe a naturellement le libre usage. Hier les grandes puissances guerrières s’appuyaient sur la force industrielle des zones les plus peuplées. Aujourd’hui elles recherchent en même temps je sûr abri que constituent les espaces vides, là secret des mouvements est mieux gardé qu’ailleurs, dans des zones où les armes secrètes trouvent des abris inviolables. A cet égard, notre Sahara sans habitants apparaît d’une manière inattendue comme une sorte de place d’armes en puissance et comme la clé de voûte de la défense des Etats africains établis sur la périphérie. On sait déjà le rôle que les zones désertiques de Libye et de Transjordanie ont joué depuis vingt ans dans la stratégie mondiale. La France, par son passé saharien et son expérience africaine, est en mesure de tenir avec fermeté cette forteresse imprenable préservée par la solitude.
***
Notre pays a entrepris la pacification du Sahara tantôt par l’Algérie, tantôt par la Sénégal et le Niger, tantôt par le Tchad. D’où la dispersion apparente des efforts. La région centrale n’a connu pendant cette période qu’une très brève période de commandement unique, celle des années de pacification qui se sont succédé après les années 1916-1917, au moment où la révolte des Touareg, encouragée en sous-main par l’Allemagne et soutenue par l’action des confréries de la Senoussiya en Cyrénaïque, a eu pour conséquence l’assassinat du P. de Foucauld à Tamanrasset. C’est alors qu’une autorité militaire étendue fut confiée au général Laperrine, qui put jeter les bases d’une action politique et d’une pénétration méthodique grâce auxquelles furent rapidement brisées les résistances suscitées par les « Empires centraux ». La mort prématurée du général Laperrine, victime d’un accident d’avion en plein désert, mit fin à cette coordination qui ne fut rétablie par la suite que sous une for,e limitée, pour réussir à pacifier les confins algéro-marocains dans la région du Dra et de Tindouf. En effet, les frontières sahariennes de l’Empire chérifien n’ayant jamais été clairement tracées, une collaboration active algéro-marocaine à l’intérieur d’un vaste commandement commun aux limites imprécises apparaissait comme le seul moyen pratique d’engager la lutte avec efficacité contre les redoutables pillards qu’étaient alors les Reguibat, les Aït Atta et les Aït Hamou. Ce commandement des confins algéro-marocains devait subsister jusqu’après la deuxième guerre mondiale. La pacification une fois acquise, cette collaboration était naturellement amenée à se relâcher. Elle a tendance aujourd’hui à disparaître, et l’on en revient lentement au morcellement du commandement.
Ce retour à la dispersion s’explique aisément. La pacification du désert avait, nous l’avons dit, pour conséquence naturelle un glissement progressif des tribus guerrières vers la zone périphérique ; en même temps s’étoffaient les administrations régulières appuyées sur les zones habitées. Ainsi peu à peu, à la grande unité géographique de ce demi continent se substitue, malgré la présence d’une seule nation, la France, établie sur tout le continent, la répartition arbitraire de cet immense territoire. Le Maroc, l’Algérie, l’Afrique Equatoriale et l’Afrique Occidentale Française se partagèrent les déserts en les rattachant aux territoires peuplés et déjà pourvus d’une administration puissante. C’est ainsi que la carte de l’Afrique nous présente aujourd’hui ces tracés rectilignes et ce découpage qui suggéreraient l’idée de partage d’un immense gâteau. Désormais chacun s’occupait de son propre désert dans la mesure d’ailleurs où celui-ci l’intéressait. Il est bien évident d’autre part que ces vastes territoires presque vides, pour lesquels se passionnent les méharistes, n’offraient aux bureaucrates des capitales lointaines qu’une attirance bien réduite.
Les zones désertiques ne se rappelaient généralement à leur attention que par leurs demandes de subsides et leurs besoins, le plus souvent mal satisfaits, de matériel moderne. Il a fallu, depuis 1940, l’équipement de deux grandes routes transsahariennes automobiles, l’une en Mauritanie, l’autre dans le centre par Bidon 5, pour restaurer l’idée d’une liaison permanent. Dans les périodes d’isolement, de 1940 à 1945, ces pistes purent tant bien que mal suppléer à la quasi-disparition du trafic périphérique en raison du blocus maritime de la guerre. Ainsi reparaissaient quelques échanges commerciaux, surtout dans la partie centrale. Aujourd’hui encore quelques milliers de tonnes de marchandises franchissent chaque année, entre Alger, Gao et Zinder, le Sahara dans les deux sens, cependant que des troupeaux de l’Adrar ses Iforas traversent le Tanezrouft et le Tidikelt pour venir contribuer au ravitaillement des oasis du Sud-algérien.
En dépit de ces maigres relations, de la publicité faite autour des raids automobiles et des randonnées touristiques et cynégétiques, le Sahara français demeure démembré, scindé arbitrairement en parties distinctes rattachées aux gouvernements côtiers, comme s’il n’avait lui-même aucune existence réelle. La création récente des assemblées locales en Algérie, en Afrique Occidentale Française et en Afrique Equatoriale Française a eu enfin pour conséquence dernière de faire apparaître une représentation élective des habitants du Sahara dont l’importance est presque nulle dans chacun des gouvernements. Mais ce fait consacre ainsi sous une forme politique le rattachement des régions presque vides du grand désert aux zones sédentaires administrées. Certes, aux regards des assemblées locales la vie des nomades n’apparaît que comme une survivance pittoresque et paradoxale qui ne mérite pas suffisamment qu’on fasse un effort pour la protéger. Mais les yeux s’habituent à contempler les lignes frontières sur la carte, et ces arpents de sable sont volontiers annexés comme un domaine en friche, dans l’esprit même de ceux-là qui n’ont pas la moindre idée de leur intérêt.
On peut penser que cette situation générale, si rien ne vient modifier le statut présent des territoires sahariens, continuera à évoluer dans le sens d’une désagrégation générale de la société nomade et d’une prépondérance constances rendront de plus en plus difficile une coordination des efforts que la mise en valeur économique du grand désert, l’utilisation de ses bases stratégiques, pourraient cependant rendre nécessaire.
C’est sous ces aspects, quelque peu décourageants à première vue, que se trouve posé aujourd’hui à la France le problème de l’avenir du Sahara. Devons-nous accepter comme irréversible cette évolution administrative et économique qui est bien plus le résultat des habitudes que celui d’une volonté réfléchie ? Ou bien devons-nous essayer, dans ce monde moderne où se posent sans cesse de nouveaux problèmes, d’adapter nos formules d’organisation aux nouveaux besoins qui se font jour ?
(A suivre.) ROBERT MONTAGNE.
Les hommes de ma génération savent encore le nom, un instant sur toutes les bouches pendant leur enfance, de Jacques Lebaudy, un homme d’affaires français qui, embarrassé par sa fortune et emporté par l’esprit d’aventure, avait conçu le projet romanesque, dont les journaux s’amusèrent alors, de fonder pour son propre compte un empire au Sahara.
Quinze ans plus tard Pierre Benoit, tirant parti de légendes du Hoggar et de la découverte archéologique du tombeau de la reine touarégue Tin Hinane, imaginait son roman de l’Atlantide. De l’histoire à demi vécue de deux officiers sahariens, il faisait sortir des solitudes du Hoggar le mirage d’une mystérieuse principauté berbère défendue par la solitude contre les curiosités de l’Occident.
En 1952 les choses ont bien changé. Un projet de loi vient d’être déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale pour proclamer l’intégration du Sahara au territoire national et décider de la création de « départements français » au cœur du grand désert. En effet, depuis quelques mois, des publicistes, des économistes et des financiers ont lancé l’idée, à la suite d’entretiens, de discussions et de publications dont la presse a fait connaître la teneur1, de favoriser par une telle décision gouvernementale l’exploitation industrielle du Sahara. Il s’agirait essentiellement de placer une partie au moins de ses territoires sous l’autorité unique et directe de la métropole, de manière à pouvoir donner une vive impulsion aux entreprises minières, dans des conditions qui réserveraient à la France l’initiative qui lui revient, puisque c’est elle-même qui a contribué, au prix d’un demi-siècle d’efforts, à ouvrir l’accès de ces régions impénétrables. Les initiateurs de ce projet avancent, avec quelque pertinence, que, si notre pays se désintéressait de cet avenir, d’autres Puissances ne tarderaient pas à prendre
____________________________________________
1. Hommes et Mondes, mai 1951 et suivants ; Figaro, 5 et 6 octobre ; le Monde, 30 mai et 26 octobre.
Cette ouvre à leur compte. Le désert a, on le voit, cessé d’être la terre du rêve pour devenir un des espaces du ,onde où peuvent se heurter les convoitises des grands Etats en même temps que l’ambition des stratèges et l’imagination des créateurs de Puissances industrielles.
Ce changement d’attitude n’a pas été cependant aussi brusque qu’il peut paraître. Depuis qu’a été achevée, en 1934,la pacification du grand désert d’Afrique, deux grands projets, partiellement réalisés d’ailleurs, ont attiré l’attention des économistes sur cette partie déshéritée du continent. Dans la boucle du Niger, à la limite sud du désert, dans ce delta intérieur où se perdaient inutilement les eaux du fleuve, la construction de grands barrages a permis avant la guerre d’entreprendre de vastes travaux d’irrigation. Les initiateurs de cette œuvre espéraient réussir ainsi à transformer le delta intérieur du Niger en une zone aussi riche, par ses plantations de coton, que la Djezireh du Haut Nil dans le Soudan anglo-égyptien. D’autre part, depuis 1932, le projet d’un chemin de fer transsaharien _ de Gao à Nemours _ était étudié pour relier cette nouvelle zone de peuplement de la boucle du Niger à la Méditerranée, en suivant la vieille voie historique d’un itinéraire transdésertique de caravane. Certains pensaient ainsi intéresser l’Algérie à la mise en valeur des richesses du Soudan et du Tchad.
Ces vestes desseins, il est vrai, n’ont jamais séduit en France et en Afrique qu’une partie de l’opinion. Certes, des événements internationaux sont intervenus pour limiter considérablement la réalisation des plans primitifs. Mais en même temps l’Office du Niger et la Transsaharien ont suscité l’un et l’autre de furieuses contre-attaques. Certains redoutaient que les irrigations du Niger ne consacrassent la mise en esclavage économique des populations noires transplantées, alors que l’Office du Niger se proposait au contraire de les libérer définitivement de la misère en les rattachant à l’économie moderne. D’autres dénonçaient le gaspillage d’argent que serait l’établissement d’une voie ferrée à travers le désert et qui resterait, disaient-ils, sans trafic et sans utilité réelle. Les promoteurs du Transsaharien répondaient, chiffres en mains, que les dépenses seraient réduites et donnaient l’exemple des nombreux chemins de fer transdésertiques du monde. Malgré les controverses, cependant, l’élan était donné. Le barrage de Sansanding construit, les irrigations se développèrent sur un plan plus modeste qu’on ne l’avait imaginé, mais dans des conditions qui, à tout prendre, se trouvèrent heureuses. D’autre part, le chemin de fer Méditerranée-Niger partant de Nemours poussant son avance au-delà de Colomb-Béchar se révélait, avant même d’avoir atteint le cœur du désert, un moyen incomparable de pénétration dans une vaste zone minière dont l’intérêt ne cosse depuis plusieurs années de s’accroître. Sur son axe et dans son prolongement, se poursuivent en effet de nos jours d’une manière continue des prospections, et des découvertes les plus engageantes se succèdent qui retiennent aujourd’hui l’attention des économistes.
Malheureusement ces deux projets avaient un instant intéressé le gouvernement de Vichy. Ils se trouvèrent par là même, aux yeux d’une opinion simpliste, entachés de cette réprobation qui, au lendemain de la Libération, frappa indistinctement toutes les entreprises sur lesquelles s’étaient reportés quelques espoirs pendant la difficile période de notre détresse nationale. Mais il s’agissait sur ce point d’un discrédit trop sentimental pour que la paralysie fût complète. Depuis trois ans, les recherches géologiques amènent à considérer avec attention la vaste zone qui s’étend depuis Fort-Gouraud en Mauritanie à 600 kilomètres à l’ouest de Villa Cisneros, en passant par les confins du Dra, Beni Abbès, jusqu’au Hoggar et à l’Aïr ; entre le Rio De Oro et la Libye. L’idée d’une « mise en valeur » du Sahara a ainsi repris corps, débarrassée de la plupart des préjugés qui en avaient précédemment limité la portée.
Nous trouvons intact en effet sur ces immenses territoires le vieux socle primaire africain dont les grands plissements tertiaires de l’Atlas maghrébin n’ont pas altéré la disposition. Les minces apports de sable ou sable ou les maigres fossiles des rivières intérieures du Sahara laissent presque partout à nu dans les régions centrales le squelette géologique du continent et les prospecteurs découvrent chaque jour dans ses fissures des indices de charbon, de cobalt de manganèse, de cuivre et d’étain.
Le France a ; depuis un siècle, assumé le rude tâche de pacifier ce continent désolé, et a fait l’effort d’y ouvrir des routes, d’y aménager des points d’eau. Est-ce elle qui prendra l’initiative d’une exploitation moderne ? Donnera-t-elle l’exemple des grandes entreprises conduites dans l’ordre et selon une sûre méthode ? Ou bien verrons-nous au contraire s’abattre sur ce pays, au hasard des circonstances, des sociétés puissantes de nationalités et d’attaches diverses, aux vues limitées, aux calculs égoïstes ? Déjà des demandes de recherches pétrolières, qui se paralyseront d’ailleurs les unes les autres, sont adressées à la France par des compagnies étrangères. La presse britannique elle-même, au lendemain de la découverte du riche gisement de fer de Fort-Gouraud, n’a-t-elle pas lancé, comme un ballon d’essai, l’idée d’une internationalisation du Sahara ? Il était naturel qu’en France l’opinion éclairée s’inquiétât de l’avenir du Sahara français et qu’une discussion fût instituée entre tous ceux que préoccupe l’intérêt national pour tenter d’intéresser le gouvernement et l’opinion de notre pays à des problèmes qui ne sont plus aujourd’hui colorés d’aucun romantisme. L’heure est venue, pour notre pays, de prendre position.
***
Le Sahara africain n’est que le dernier maillon de cette chaîne de déserts et de steppes de la zone subtropicale qui, depuis la Chine, l’Inde et l’Iran, se prolonge par la péninsule Arabique, les déserts d’Egypte et de Libye. A la vérité, la géographie comme l’histoire unissent pratiquement, malgré les deux coupures de la mer Rouge et du golfe Persique, en un seul bloc géographique tous les espaces vides qui s’étendent entre le golfe Persique et l’Atlantique, entre les parallèles 16° et 32° Nord.
La similitude du climat dans une région où les chutes de pluies sont inférieures à 100 millimètres par an, la prépondérance de la vie pastorale, la succession régulière des invasions de nomades berbères et arabes font de ces régions une sorte de continent à part, qui a été par excellence la zone en bordure de laquelle s’est faite_sur ses limites septentrionales et méridionales _ l’expansion de l’Islam.
Mais en même temps, dans cet immense territoire, le Sahara occidental, celui de ces déserts qui nous intéresse particulièrement et qui a pour limites mêmes celles des territoires placés sous l’autorité de la France dans le Sud algérien, l’Afrique Occidentale Française et la Tchad, a eu des destinées historiques particulières qui lui confèrent une originalité propre, sur lesquelles il nous faut réfléchir.
On sait qu’à l’aube de l’histoire cette vaste zone, aujourd’hui dépeuplée, apparaissait, par les races qui l’occupaient, comme un prolongement naturel de l’Afrique Noire. Dans les oasis du Sahara algérien et la Libye se trouvaient des populations foncées que les Grecs désignaient sous le nom de nubiens, et qui étaient peut-être de même origine que les Haoussa et Toubbous ou appartenaient aux races éthiopiennes, très différentes de celles qui occupent aujourd’hui le Soudan. Il se peut que des débris de ces populations noires, refoulées ou détruites par les invasions postérieures, aient subsisté jusqu’à nos jours dans les oasis du Touat et du Dra. Ce sont elles qui formeraient le fond primitif de ces cultivateurs noirs désignés généralement sous le nom de Haratine. Il est vrai qui la pratique de l’esclavage introduisit par la suite dans ces régions d’oasis pendant de longs siècles des éléments importés du Soudan ou même des régions bantoues, de telle sorte que nous ne sommes plus en état de retrouver avec exactitude dans les cultivateurs noirs des palmeraies sahariennes les descendants de ces habitants primitifs du Sahara.
Plus tard, les invasions de nomades berbères, dont nous ne pouvons préciser la date, mise qui sont bien antérieures aux conquêtes romaines, aboutirent à l’unification presque complète, par les premiers conquérants blancs, du désert et des zones méditerranéennes.
A partir du dixième siècle de notre ère, apparaissent à leur tour, suivant la périphérie du Sahara ; les envahisseurs arabes en Egypte, au Soudan anglo-égyptien, puis en Libye. Leurs groupes se fixent dès ce moment dans le territoire du Tchad. Puis avec les invasions puissantes des Soleim et des Beni Hilal à partir du onzième siècle, et avec celles de Maqil au treizième siècle, les vagues d’invasion déferlent sur la Tunisie, l’Algérie, le Maroc pour s’infiltrer peu à peu sur la côte atlantique en partant de l’Oued Dra vers le Sénégal. La conquête de la Mauritanie par les Arabes sur les Berbères s’achève au dix-huitième siècle. Les Berbères nomades sont confinés ou refoulés. Leurs descendants n’ occupent plus guère que le centre du désert autour de l’Aïr, du Hoggar, débordant cependant en oblique vers le nord-ouest jusqu’aux confins de l’Atlas marocain. C’est à ce moment que le peuplement ethnique du Sahara nous apparaît comme stabilisé.
Mais c’est alors que l’intervention de l’Occident va transformer les conditions de la via au désert. En dépit du caractère dévastateur et souvent violent des conquêtes berbères, le Sahara avait connu depuis le haut moyen âge une vie commerciale intense que nous n’imaginons plus aujourd’hui qu’avec peine. Il était en effet traversé du nord au sud par des grandes routes parallèles qui unissaient les royaumes noirs plus ou moins islamisés du Soudan aux rives de la Méditerranée. Parmi ces grandes routes, citons surtout celle du Tchad à Tripoli, celle du Niger à l’Oued Dra et celle du Sénégal au pays du Sous. Ces itinéraires étaient les routes des esclaves, de l’or, des cotonnades africaines ou des plumes d’autruche, parcourues du sud au nord. Au retour, elles acheminaient les objets fabriqués venus du Maghreb ou d’Europe, la poudre, les armes et la verroterie.
Dès la fin du dix-huitième siècle le développement du commerce maritime moderne sur les côtes du golfe de Guinée allait altérer le sens des échanges. Les productions de l’Occident parviennent dès lors au Soudan par le Sud et les traitants établis sur les comptoirs de l’Atlantique exportent directement par leurs navires le « bois d’ébène », la poudre d’or et l’ivoire. Les routes transsahariennes dépérissent. Bientôt les conquêtes occidentales en Afrique Noire vont achever cette décadence, cependant qu’au Maghreb même l’administration moderne des Etats rendra possibles les relations directes avec l’Europe.
Les dernières années du dix-neuvième siècle précipitent la décadence et bientôt la pacification totale des zones désertiques provoque un changement plus important encore : l’effondrement politique de la société nomade.
Si l’on veut bien comprendre les conditions dans lesquelles se pose aujourd’hui à la France et au monde entier le problème de l’exploitation moderne du Sahara, Il faut en effet tenir compte de l’immense transformation apportée à ces territoires par la pacification définitive. Et pour saisir toute l’importance de ce changement, il faut évoquer tout d’abord ce qu’était la situation politique des tribus guerrières de l’intérieur de l’Afrique Blanche au temps où celles-ci vivaient dans l’anarchie.
En Afrique, comme dans la péninsule arabique, la domination du désert appartenait naguère à quelques grandes tribus guerrières, extrêmement mobiles, utilisant pour leurs expéditions lointaines des chameaux agiles qui leur permettaient d’échapper à toutes les poursuites. Les quelques bases permanentes dont disposaient ces nomades chameliers au centre du Sahara étaient ainsi inaccessibles aux forces des gouvernements périphériques qui eussent tenté de les y atteindre. L’Empire du Maroc, l’Empire turc, les royaumes du Soudan n’osaient pas s’aventurer à les combattre dans les solitudes redoutables du grand désert. Aussi ces pasteurs guerriers capables de subsister, lorsqu’ils le voulaient, dans la partie centrale, faisaient-ils sentir le poids de leurs armes sur les tribus périphériques moins belliqueuses qui vivaient plus près des marches du désert, où l’on pratiquait plus aisément un élevage régulier. Souvent même leurs raids les menaient jusqu’aux zones sédentarisées occupées dans le Sud par les Noirs, ou dans je Nord par les tribus arabes stabilisées au pied de l’Atlas. En même temps, les maîtres du Sahara central tenaient sous leur étroite domination les habitants des oasis, ces noirs paisibles ravalés depuis des dizaines de siècles à la situation de sédentaires asservis. De temps à autre l’une ou l’autre de ces grandes tribus, lorsqu’elle était vaincue par une rivale, éclatait elle-même et se dispersait à son tour sur les rives du Sahara. On trouve encore, en étudiant l’origine ethnique des petits groupes qui sont fixée à la li,ite de la sédentarisation, des descendants de ces anciens dominateurs berbères ou arabes, dont le no, faisait, dans les siècles passés, trembler les commerçants ou les agriculteurs des confins. Ces grandes tribus, dont celle des Reguibat, célèbre par ses combats contre la France et l’Espagne il y a vingt ans, nous donne le dernier exemple, avaient cette double particularité, étrange à nos yeux, d’être à la fois militairement puissantes et matériellement très pauvres. La via au désert était pour ces guerriers une sorte d’épopée permanente, entièrement occupée par des raids à grande distance, remplie par l’exécution de vengeances entre clans rivaux, une sorte de misère héroïque dans laquelle le dénuement allait de pair avec la noblesse et la générosité fastueuse avec la pauvreté.
Lorsque la pacification des confins eut été rendue possible par la création de troupes méharistes bien organisées, pourvues d’armes modernes, appuyées par les liaisons automobiles et soutenues par les progrès matériels d’une action continue exercée pendant des dizaines d’années, le jour vint où cette société nomade guerrière du centre du désert fut à son tour contrainte à signer la paix. En rendant leurs armes, ces grands bédouins chameliers perdirent en quelque sorte leur raison de vivre. L’on vit alors se précipiter avec une rapidité jusqu’alors inconnue le grand mouvement historique, jadis assez lent, qui a toujours porté les populations nomades du centre vers la périphérie. C’est ainsi que _ de 1900 à 1950 _ le centre du désert s’est vidé peu à peu au détriment des rives du Sahara. Seuls subsistent aujourd’hui, de ces puissantes confédérations guerrières de l’intérieur, quelques groupes nomades évoluant autour de quelques points d’appui naturels et limitant leurs déplacements aux nécessités économiques du pâturage. Dans la région centrale, dont la superficie est huit fois et demie égale à celle de la France, entre le Rio-de-Oro et l’Aïr, entre l’Adrar des Iforas et la région de Beni-Abbès, on ne compte guère plus de 220.000 habitant1, parmi lesquels d’ailleurs une faible part de sédentaires d’osais. Nous sommes donc là devant une terre vide et les problèmes humains, si intéressants à résoudre qu’ils soient encore, n’ont plus ici aucune importance politique. Cette terre, déjà très pauvre, qu’habitaient seulement d’héroïques bandits, est aujourd’hui presque abandonnée par l’homme. Le désert ne vivait que grâce à la guerre.
La paix en a chassé la plupart de ses fils.
1 . L’ensemble du Sahara, en comptant les zones périphériques où les nomades ont des relations avec les sédentaires des pays côtiers, a onze fois et demie la surface de la France et un million neuf cent mille habitants nomades, y compris les Peuls, nomades sahéliens.
observons qu’il s’agit ici d’une évolution naturelle dans laquelle n’a joué, bien au contraire, aucun calcul d’éviction. Beaucoup d’officiers s’étaient pris d’amitié pour ces nomades belliqueux, si attachants, et ils eussent souhaité les voir, sur place, se transformer en paisibles pasteurs. Mais avec l’édifice politique de leur puissance a disparu le système social qui les faisait vivre. Par suite de l’établissement de la paix, les liens qui unissaient les protecteurs aux protégés, les grands nomades aux petits nomades et aux sédentaires, se sont trouvés brisés. L’attrait du rezzou, de l’expédition de pillage, ayant disparu, l’idéal plus matériel de la vie sédentaire s’est peu à peu imposé. Les nomades se sont rapprochés des centres permanents. Leurs troupeaux, dont les parcours se sont amenuisés, ont diminué peu à peu. Ceux qui vivaient sur les limites des pays agricoles en ont délibérément passé la frontière et se sont enfoncés progressivement vers les savanes herbeuses. Sur la rive sud du Sahara surtout on a observé une descente presque générale des tribus qui, peu à peu d’ailleurs, au contact des populations noires, se métissent et s’alourdissent.
Mais la paix avait encore d’autres conséquences désastreuses jusque dans les zones de bordure désormais surpeuplées. Sur les confins sahariens du Maroc, les grands nomades, qui ont conquis les oasis du Bani il y a cinquante ans, se trouvent aujourd’hui dépourvus d’autorité sur leurs sujets noirs ou sur les Berbères sédentaires qu’ils opprimaient jadis. Leurs anciens vassaux vont aujourd’hui travailler dans les mines et dans les ports, cependant qu’eux-mêmes, incapables de cultiver les palmiers, tombent peu à peu dans la misère. Bientôt les pasteurs abandonneront à leur tour ces marches frontières et s’en iront, en tentes isolées, se perdre parmi les sédentaires du Maroc du Nord.
***
Ce vide progressif du Sahara fait aujourd’hui du cœur du continent africain une terre presque sans hommes, dont la situation devient analogue à tant de déserts chauds ou froids qui parsèment la planète. Le Sahara central, avec ses richesses minières potentielles, ressemble ainsi plus ou moins à l’Alaska ou au Groenland. Les populations indigènes si dispersées qui y vivent encore en nomades ou en sédentaires d’oasis ne peuvent naturellement pas revendiquer la propriété éventuelle des mines ou des champs de pétrole hypothétiques, pas plus que les Esquimaux du Grand Nord ne pourraient réclamer de droits sur la mise en valeur de gisements d’uranium. Les problèmes changent de face. L’économie l’emporte sur la politique. Nous entrons ici dans le régime de la technique industrielle et dans le domaine presque sans partage de la puissante économie moderne.
Dans ces conditions, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et d’exploiter les ressources locales ne peut être invoqué puisqu’il n’existe pratiquement pas sur place de peuples qui occupent le pays. Il subsiste seulement çà et là de pauvres communautés humaines résiduelles, qui méritent d’ailleurs de bénéficier d’une assistance économique et morale. L’Occident, qui a ruiné leur puissance en leur imposant la paix, doit être aussi assez généreux pour permettre à ceux qui sont restés de survivre dans un monde nouveau qui leur est étranger.
A cet égard, la France est mieux placée qu’aucun autre pays pour aborder cette tâche humaine, qui n’est pas sans grandeur. Elle peut exciper d’une longue tradition d’humanité à l’égard des peuples de l’Afrique Blanche. Elle dispose de cadres admirables, de spécialistes des tribus. Qui donc mieux qu’elle pourrait apporter aux nomades Arabes, Berbères ou Teda, qui sont restés sur place, une aide comparable à celle que le Danemark a su donner aux habitants du Groenland et que l’Amérique du Nord accorde si généreusement aux Esquimaux du La broder ?
Une autre conséquence inattendue de la création progressive du « vide saharien » apparaît dans le domaine militaire. Il faut en effet ajouter aux considérations générales précédentes que le centre de l’Afrique prend aujourd’hui dans la stratégie mondiale un intérêt particulier. Au temps où les grandes routes stratégiques sillonnent les continents, le cœur du désert devient par lui-même d’une manière paradoxale une sorte de « plaque tournante », dont la nation qui l’occupe a naturellement le libre usage. Hier les grandes puissances guerrières s’appuyaient sur la force industrielle des zones les plus peuplées. Aujourd’hui elles recherchent en même temps je sûr abri que constituent les espaces vides, là secret des mouvements est mieux gardé qu’ailleurs, dans des zones où les armes secrètes trouvent des abris inviolables. A cet égard, notre Sahara sans habitants apparaît d’une manière inattendue comme une sorte de place d’armes en puissance et comme la clé de voûte de la défense des Etats africains établis sur la périphérie. On sait déjà le rôle que les zones désertiques de Libye et de Transjordanie ont joué depuis vingt ans dans la stratégie mondiale. La France, par son passé saharien et son expérience africaine, est en mesure de tenir avec fermeté cette forteresse imprenable préservée par la solitude.
***
Notre pays a entrepris la pacification du Sahara tantôt par l’Algérie, tantôt par la Sénégal et le Niger, tantôt par le Tchad. D’où la dispersion apparente des efforts. La région centrale n’a connu pendant cette période qu’une très brève période de commandement unique, celle des années de pacification qui se sont succédé après les années 1916-1917, au moment où la révolte des Touareg, encouragée en sous-main par l’Allemagne et soutenue par l’action des confréries de la Senoussiya en Cyrénaïque, a eu pour conséquence l’assassinat du P. de Foucauld à Tamanrasset. C’est alors qu’une autorité militaire étendue fut confiée au général Laperrine, qui put jeter les bases d’une action politique et d’une pénétration méthodique grâce auxquelles furent rapidement brisées les résistances suscitées par les « Empires centraux ». La mort prématurée du général Laperrine, victime d’un accident d’avion en plein désert, mit fin à cette coordination qui ne fut rétablie par la suite que sous une for,e limitée, pour réussir à pacifier les confins algéro-marocains dans la région du Dra et de Tindouf. En effet, les frontières sahariennes de l’Empire chérifien n’ayant jamais été clairement tracées, une collaboration active algéro-marocaine à l’intérieur d’un vaste commandement commun aux limites imprécises apparaissait comme le seul moyen pratique d’engager la lutte avec efficacité contre les redoutables pillards qu’étaient alors les Reguibat, les Aït Atta et les Aït Hamou. Ce commandement des confins algéro-marocains devait subsister jusqu’après la deuxième guerre mondiale. La pacification une fois acquise, cette collaboration était naturellement amenée à se relâcher. Elle a tendance aujourd’hui à disparaître, et l’on en revient lentement au morcellement du commandement.
Ce retour à la dispersion s’explique aisément. La pacification du désert avait, nous l’avons dit, pour conséquence naturelle un glissement progressif des tribus guerrières vers la zone périphérique ; en même temps s’étoffaient les administrations régulières appuyées sur les zones habitées. Ainsi peu à peu, à la grande unité géographique de ce demi continent se substitue, malgré la présence d’une seule nation, la France, établie sur tout le continent, la répartition arbitraire de cet immense territoire. Le Maroc, l’Algérie, l’Afrique Equatoriale et l’Afrique Occidentale Française se partagèrent les déserts en les rattachant aux territoires peuplés et déjà pourvus d’une administration puissante. C’est ainsi que la carte de l’Afrique nous présente aujourd’hui ces tracés rectilignes et ce découpage qui suggéreraient l’idée de partage d’un immense gâteau. Désormais chacun s’occupait de son propre désert dans la mesure d’ailleurs où celui-ci l’intéressait. Il est bien évident d’autre part que ces vastes territoires presque vides, pour lesquels se passionnent les méharistes, n’offraient aux bureaucrates des capitales lointaines qu’une attirance bien réduite.
Les zones désertiques ne se rappelaient généralement à leur attention que par leurs demandes de subsides et leurs besoins, le plus souvent mal satisfaits, de matériel moderne. Il a fallu, depuis 1940, l’équipement de deux grandes routes transsahariennes automobiles, l’une en Mauritanie, l’autre dans le centre par Bidon 5, pour restaurer l’idée d’une liaison permanent. Dans les périodes d’isolement, de 1940 à 1945, ces pistes purent tant bien que mal suppléer à la quasi-disparition du trafic périphérique en raison du blocus maritime de la guerre. Ainsi reparaissaient quelques échanges commerciaux, surtout dans la partie centrale. Aujourd’hui encore quelques milliers de tonnes de marchandises franchissent chaque année, entre Alger, Gao et Zinder, le Sahara dans les deux sens, cependant que des troupeaux de l’Adrar ses Iforas traversent le Tanezrouft et le Tidikelt pour venir contribuer au ravitaillement des oasis du Sud-algérien.
En dépit de ces maigres relations, de la publicité faite autour des raids automobiles et des randonnées touristiques et cynégétiques, le Sahara français demeure démembré, scindé arbitrairement en parties distinctes rattachées aux gouvernements côtiers, comme s’il n’avait lui-même aucune existence réelle. La création récente des assemblées locales en Algérie, en Afrique Occidentale Française et en Afrique Equatoriale Française a eu enfin pour conséquence dernière de faire apparaître une représentation élective des habitants du Sahara dont l’importance est presque nulle dans chacun des gouvernements. Mais ce fait consacre ainsi sous une forme politique le rattachement des régions presque vides du grand désert aux zones sédentaires administrées. Certes, aux regards des assemblées locales la vie des nomades n’apparaît que comme une survivance pittoresque et paradoxale qui ne mérite pas suffisamment qu’on fasse un effort pour la protéger. Mais les yeux s’habituent à contempler les lignes frontières sur la carte, et ces arpents de sable sont volontiers annexés comme un domaine en friche, dans l’esprit même de ceux-là qui n’ont pas la moindre idée de leur intérêt.
On peut penser que cette situation générale, si rien ne vient modifier le statut présent des territoires sahariens, continuera à évoluer dans le sens d’une désagrégation générale de la société nomade et d’une prépondérance constances rendront de plus en plus difficile une coordination des efforts que la mise en valeur économique du grand désert, l’utilisation de ses bases stratégiques, pourraient cependant rendre nécessaire.
C’est sous ces aspects, quelque peu décourageants à première vue, que se trouve posé aujourd’hui à la France le problème de l’avenir du Sahara. Devons-nous accepter comme irréversible cette évolution administrative et économique qui est bien plus le résultat des habitudes que celui d’une volonté réfléchie ? Ou bien devons-nous essayer, dans ce monde moderne où se posent sans cesse de nouveaux problèmes, d’adapter nos formules d’organisation aux nouveaux besoins qui se font jour ?
(A suivre.) ROBERT MONTAGNE.








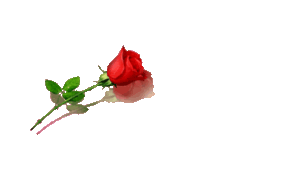
0 شــارك بـرأيــك:
إرسال تعليق